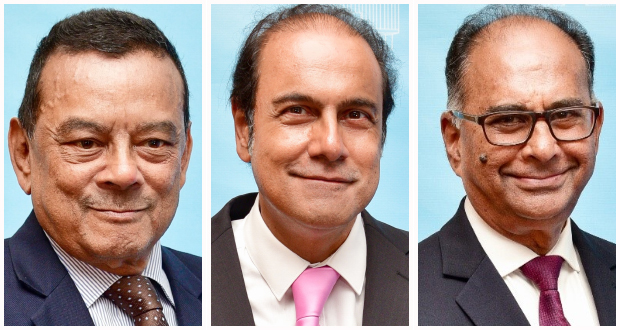Publicité
Ananda Devi, écrivain
«J’espère mourir le stylo à la main»
Par
Partager cet article
Ananda Devi, écrivain
«J’espère mourir le stylo à la main»

Ananda Devi, écrivain (© J.-F. PAGA, GRASSET)
Un demi-siècle d’écriture, c’est ce qu’Ananda Devi fêtera demain, dimanche 15 octobre, au Festival du livre de Trou-d’Eau-Douce. Elle interviendra à 13 heures, face au modérateur Tirthankar Chanda, journaliste à Radio France International. De la jeune fille de Trois Boutiques, qui, à 15 ans, était parmi les dix gagnants d’un concours de nouvelles radiophoniques de l’Office de Radiodiffusion-Télévision Française, à l’écrivain primée, Ananda Devi remonte la rivière de l’existence. Avec sincérité.
Après 50 ans d’écriture, vous dites que la petite fille de Trois Boutiques que vous étiez, «n’était pas un monstre mais elle le deviendrait». Pour écrire, il faut assumer sa part de monstruosité ?
Mes débuts en écriture ont été accomplis en douceur, avec des histoires d’enfants, des contes, des poèmes écrits dans l’innocence. Mais cette innocence a, dès l’adolescence, laissé la place à une inspiration plus sombre, dont je ne percevrais pas d’emblée le sens profond, ni les lieux étranges où elle me conduirait. La nouvelle qui m’a «lancée», intitulée La cité Attlee et primée au concours de la meilleure nouvelle de langue française de l’ORTF (Radio France aujourd’hui), m’a été inspirée, à l’âge de 15 ans, lors d’une visite de cette cité avec les religieuses du Couvent de Lorette de Curepipe. Chaque année, avant la Noël, elles emmenaient des élèves distribuer des jouets aux enfants des quartiers défavorisés. Cette année-là, j’en faisais partie. Et j’ai découvert, pas très loin de Forest-Side où j’habitais, le gouffre qui séparait ceux dont la vie était confortable de ceux qui n’avaient pratiquement rien. Je suis rentrée et j’ai écrit d’un seul trait la nouvelle : une petite fille de 13 ans, Christiane, l’aînée d’une fratrie de huit enfants, dont la mère travaille comme femme de ménage et le père est au chômage, fréquente la même école que moi, et écrit en secret des histoires dans des cahiers scolaires. Je raconte son quotidien, comment lorsqu’elle rentre, elle doit s’occuper de ses frères et sœurs, tout faire à la maison pour aider sa mère épuisée. Mais à la fin de la nouvelle, sa mère, à nouveau enceinte, meurt en couches. Christiane regarde le corps déchiré de sa mère et comprend que désormais, c’est elle qui devra prendre la relève et travailler pour nourrir la famille. Avec une sorte de résignation, elle prend les cahiers dans lesquels elle a écrit ses histoires et déchire en mille morceaux les feuillets, qui sont emportés par le vent. Je crois que cela se termine par l’idée que ce sont ses rêves que le vent emporte ainsi.
C’était une entrée en matière dans un univers qui serait toujours le mien : voir de l’intérieur des personnages, le plus souvent silencieux et seuls, amenés à affronter la violence du monde. Et au cours de ce cheminement, force m’a été de suivre des voies ténébreuses, de faire entendre des voix terrifiantes, d’aller vers les monstres qui dévastent, qui écrasent, qui détruisent, pour tenter de comprendre d’où ils viennent. Pour parvenir à cela, il me semble qu’il fallait aussi que je devienne en quelque sorte monstrueuse, car sinon, comment aurais-je pu les comprendre ? Je parle de ce dédoublement dans Indian Tango. J’ai l’apparence d’une femme douce. Mais l’écrivaine, elle, est impavide. Aucun interdit ne l’arrête.
À quel moment la petite fille a-t-elle accepté qu’elle est écrivain, qu’elle n’écrit pas en vain ?
Ah, il y a deux réponses à cela : dès le début, je savais que je voulais écrire. Que c’était la chose que j’aimais le plus au monde, il n’y avait pas un jour où je n’écrivais pas quelque chose. La mère d’une amie à laquelle je donnais mes textes à lire m’a dit, quand j’avais 17 ou 18 ans : «Tu écris comme tu respires !». C’était tout à fait cela – l’écriture me tenait lieu de respiration. Par contre, j’ai mis énormément de temps à dire aux autres que j’étais écrivain. Même après avoir publié plusieurs livres, j’avais du mal à me présenter ainsi, craignant d’usurper une place qui n’était pas la mienne. Je savais que j’écrirais toujours. Était-ce suffisant pour se dire écrivain ? J’étais convaincue que j’avais un peu de talent mais que cela ne me permettrait jamais d’atteindre le niveau des grands écrivains que j’admirais. J’étais minée par un manque total de confiance en moi alors que, paradoxalement, j’avais foi en ce besoin d’écrire qui me porterait toute ma vie. Aujourd’hui, je ne le regrette pas car cela m’a poussée à retravailler mes textes avec acharnement et à ne rien tenir pour acquis. Surtout, à ne pas céder à une sorte de complaisance qui m’aurait incitée à m’asseoir sur mes lauriers, quels qu’ils soient. À chaque fois que je termine un livre, je me demande toujours : quel sera le prochain ? Comment puis-je aller plus loin ?
Qu’est-ce qui vous a donné la force de passer outre les critiques de vos débuts, qui vous ont cataloguée de «trop sombre», «trop difficile à lire», «pas assez couleur locale» ?
Après la parution de mon premier recueil de nouvelles, Solstices, que écrites écrit entre 17 et 19 ans, j’ai été interviewée par la MBC. La première question a été : «Vous ne trouvez pas que ces nouvelles sont un peu morbides ?». J’étais, je l’ai dit, d’une extrême timidité. J’étais paralysée d’être à la télé. Je ne me souviens pas de ma réponse ! Oui, on m’a souvent dit que mes romans étaient difficiles à lire, et même mon mari, bien avant notre mariage, lorsque je lui ai donné un texte à lire, m’a dit qu’il avait eu besoin d’un dictionnaire ! Lorsque j’ai envoyé Rue la Poudrière, écrit dans les années 80, aux éditeurs français, j’ai reçu des refus, et effectivement, l’un d’eux m’a dit qu’il n’y avait pas assez de couleur locale alors que le roman se passait à Port-Louis dans les années 70, pendant la grève des dockers et qu’on était dans un univers totalement mauricien et local ! Ce qu’ils voulaient dire par-là c’était qu’il n’y avait pas l’exotisme qu’on attend des écrivains des îles. Le fait est que j’étais plutôt difficile à catégoriser, pour eux. Venant d’une île, avec des origines indiennes dans lesquelles je puisais une part de mon inspiration (surtout des mythes), conjuguant violence et sensualité, prose et poésie, je ne m’inscrivais dans aucun courant. D’où la difficulté à trouver un éditeur.
Vous avez publié chez Gallimard mais votre dernier roman «Le jour des caméléons», est sorti le mois dernier chez Grasset. Mais vous n’oubliez pas les «longues années de galère». Qu’est-ce que la galère vous a enseigné ?
Ces années de galère m’ont appris à être encore plus exigeante avec moi-même. Avec le recul, je vois bien que, même si tout ce que je suis est déjà contenu dans les nouvelles de Solstices, je veux dire, mes obsessions, ma manière d’écrire, mon exploration de la violence, la présence du corps et de la chair, il n’empêche que tout ce que j’ai écrit avant Moi, l’interdite , fait partie de mes œuvres de jeunesse. À partir de là, il m’a semblé que j’avais trouvé ma voix, et d’une certaine façon, je comprenais pourquoi j’avais mis du temps à trouver un «grand» éditeur. Ce n’était pas la seule raison, bien sûr.
Je suis de la génération des écrivains dits «francophones», qui avaient beaucoup de mal à se faire une place dans le domaine littéraire français. Nos livres étaient confinés à une sorte de géographie littéraire mineure, que ce soit chez les éditeurs, dans la presse ou dans les librairies. Le mot «francophone» avait une résonance un peu méprisante. En 2007, j’ai signé un manifeste dans le journal Le Monde, intitulé Pour une littérature-monde en français, où tout cela était remis en question. Ce n’était pas ce manifeste qui a changé les choses mais il a provoqué un débat, et je pense que cela a été salutaire. Aujourd’hui, les éditeurs cherchent, au contraire, ces écrivains et écrivaines qui bousculent la littérature. Nous ne sommes plus des bêtes de foire à exhiber de temps en temps. Un Mbougar Sarr ( NdlR : prix Goncourt 2021 ), pour ne citer que lui, et qui me semble avoir un talent vraiment extraordinaire, est la preuve que ce combat était nécessaire.
Vous êtes dans la première sélection du prix Médicis 2023. Vous avez remporté de nombreux prix littéraires. Après un demi-siècle d’écriture, que représentent les prix ?
Les prix sont toujours un cadeau, cela fait toujours plaisir. Cela dit, il y a tant de facteurs en jeu, surtout pour les grands prix, que l’on ne peut s’attendre à quoi que ce soit. Je suis surtout, pour ma part, reconnaissante envers les universitaires qui continuent à faire vivre des textes, des décennies plus tard. En librairie, un livre qui vient de sortir reste visible environ trois mois, après quoi il est remplacé par d’autres nouvelles sorties, sauf si c’est un best-seller. Les universités, elles, offrent une sorte de continuité extraordinaire et c’est merveilleux de voir d’anciens étudiants, aux Etats-Unis, par exemple, qui ont écrit des thèses sur nos livres, devenir profs et enseigner ces livres à leur tour. Donc, oui, je suis heureuse de recevoir des prix, mais je le suis encore plus lorsque des étudiants du monde entier m’écrivent.
Écrire pendant 50 ans et ne pas vivre de sa plume. Vous avez été linguiste, traductrice à l’Organisation Mondiale de la Propriété (OMPI) Intellectuelle. Avec le recul, cela vous paraît-il injuste ?
Pour ma part, non, cela ne me paraît pas injuste. J’ai commencé à travailler à l’OMPI, agence spécialisée sur la propriété intellectuelle à Genève, parce que, face aux difficultés de l’édition, je plongeais dans une sorte de dépression. Je me suis dit qu’il me fallait sortir de moi-même et surtout me sentir indépendante financièrement. Cela m’a permis de prendre du recul. Et surtout, d’être très disciplinée par rapport à l’écriture. Dans la journée, je traduisais des textes techniques et scientifiques de pointe (qui m’ont beaucoup appris), et le soir et le week-end, je reprenais ma casquette d’écrivain. Il y a finalement très peu d’écrivains qui vivent exclusivement de leurs livres. Du coup, je n’avais pas besoin de publier constamment pour gagner ma vie, je pouvais attendre d’être certaine que mon texte soit vraiment achevé. Cela m’a libérée.
Vos occupations professionnelles ne vous ont pas empêchée de toucher à divers genres : roman, poésie, essai, cinéma. Vous avez dit que «l’écriture, toute ma vie, a été une manière de me sentir vivante». C’est toujours aussi vrai ?
Oui, c’est toujours aussi vrai. Et je suis fascinée par toutes les formes d’écriture. Pour le roman, la nouvelle ou la poésie, ce sont les textes eux-mêmes qui imposent leur forme. Sauf pour Eve de ses décombres , qui a commencé comme un poème et s’est transformé en roman poétique, la forme de mes autres textes s’est plus ou moins imposée dès le début. L’écriture de scénarios m’a fascinée, même si cela me prend beaucoup plus de temps que ceux qui en ont fait leur métier. Dès le début, j’ai compris que ce que je devais sacrifier, c’était mon écriture elle-même : personne ne parle comme les personnages d’un de mes romans. Pendant les confinements de la pandémie, j’ai écrit une pièce de théâtre, ainsi qu’un roman humoristique en anglais, mettant en scène les divinités de la mythologie indienne. Donc, oui, c’était une manière de me sentir vivante, mais aussi, de temps en temps, de m’amuser !
L’identification à vos personnages, leur faire dire «Je» est un moteur de vos romans. Pourquoi est-ce important pour vous ?
La majorité de mes romans et nouvelles sont écrits à la première personne, effectivement. C’est la meilleur manière, à mon sens, de vivre ce que vivent mes personnages, de penser comme eux, d’être dans leur peau, leur corps, leurs émotions. Le plus difficile a été le narrateur du Sari vert. Mais aussi l’adolescente de Manger l’autre car il me fallait m’imaginer souffrant d’obésité morbide, tout en sachant que je ne pourrais jamais vivre ce que vivent les personnes souffrant de cette pathologie. Mais ce n’était pas vraiment un choix. Dans les nouvelles de Solstices , je me suis mise dans la peau d’une vieille femme, d’un homme quadragénaire, d’un jeune homme amoureux et j’en passe. Ce qui me fascinait, vraiment, c’était de n’être pas moi.
Après 50 ans d’écriture, êtes-vous habitée par une urgence d’écrire, parce que le temps qui passe ne reviendra pas ?
Oui, absolument. J’ai 66 ans. Je vais bien mais rien ne me dit que demain, quelque chose ne se détraquera pas dans mon corps. Ma mère est morte à 62 ans. J’ai écrit, lorsque je suis arrivée à cet âge, un texte intitulé Je danserai sur tes braises , où je reviens poétiquement sur ma relation avec elle, sur ce que je ne lui ai pas dit, sur ce que j’ai compris depuis ce temps. Ce texte est suivi de poèmes intitulés Six décennies où je parle du fait que je les ai atteintes, ces six décennies, et ce que cela signifie pour moi, pour mon identité, pour mes désirs. Je n’ai pas fini de vivre. Je n’ai pas non plus fini d’écrire. J’espère mourir le stylo à la main.

Ananda Devi, 15 ans, élève du Couvent de Lorette de Curepipe en 1972. Elle est parmi les 10 lauréats d’un concours de nouvelles de l’ORTF, aujourd’hui Radio France. (© ARCHIVES DE L’EXPRESS)
Publicité
Les plus récents